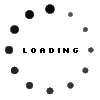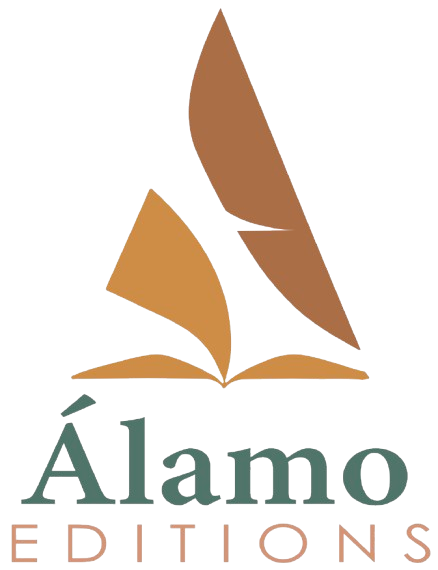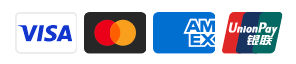Apprendre à raconter…
… est une véritable gageure pour qui, en son temps, a eu la prétention, un rien démesuré, d’accepter de le faire et se retrouve, séance tenante, confronté à un public d’étudiants en illustration et bandes dessinées, plus ou moins jeunes, issu de milieux divers et surtout variés !
Non seulement vous vous apercevez bien vite que vos trente années d’expériences et de roublardises de professeur d’histoire et de géopolitique ne forment, en fait, qu’un pauvre bagage mais aussi que, une fois la première séance portant sur les quelques techniques scénaristiques épuisée, vous êtes confronté à la réalité de votre engagement en la matière : enseigner la création et stimuler l’imaginaire d’un public avec lequel vous partagez si peu de références, écart d’âge oblige, si ce n’est votre humanité. La belle affaire !
Evidemment, tout le monde s’accorde à dire que notre imagination se nourrit, entre toutes autres choses, d’un vaste banquet où culture et expériences, œuvres impactantes et vécu composé de joies, grandes et petites, et des drames de l’existence propres à chaque être humain sont autant de plats offerts à notre appétit susceptible, ainsi, d’être à jamais rassasié.
Oui, peut-être… Mais comment donner l’envie du premier coup de fourchettes, inviter à découvrir de nouvelles saveurs et, surtout, ne pas imposer ses propres goûts ou préférences
culinaires ?
Par le partage, tout simplement. En acceptant, humblement, de jouer autant le rôle de convives que d’amphitryon. En confrontant ses opinions avec gourmandise, en mettant la main à la pâte dans la posture du marmiton ou du premier commis de cuisine car, fût-il au départ solitaire, le travail de création ne peut se passer d’ingrédients extérieurs comme la critique, la relecture ou la remise en cause aussi doux-amers, acides ou sucrés soient-ils. C’est votre plat, bien sûr, vous en êtes le chef, mais si une pincée de ceci ou de cela en rehausse la saveur, il n’en sera que meilleur. Et puis, il faut espérer que vous ne serez pas le seul à le déguster !
Bon appétit à toutes et à tous !
Berko